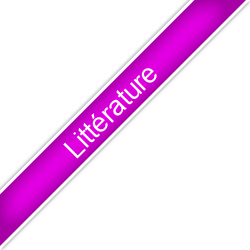
L’IMPRESSION D’ÉVIDENCE : COMMENT Y ÉCHAPPER ?
Nous voici devant une page inconnue, une phrase complexe, un simple beau vers. Notre première réaction est souvent un sentiment d’évidence: eh bien quoi, cette phrase dit bien ce qu’elle veut dire ! Ce vers est magnifique, il suffit de le prononcer ! Qu’ajouter, puisque ça coule de source ? Pourquoi analyser ? Comment faire ? Par quel bout prendre le texte ? Comment entrer dans son tissu ?
Ce sentiment d’évidence nous bloque souvent à la première lecture. Les choses paraissent tellement aller de soi que le candidat se demande ce qu’il doit expliquer. Il est conduit alors à répéter l’idée du texte, à en délayer la formulation : il fait ce qu’on appelle de la paraphrase. Pour sortir de ce blocage, il nous faut reprendre et approfondir la distinction faite dans un article précédent entre ce que dit le texte et la façon dont il le dit.
Prenons l’exemple d’un vers de Racine qui, plus qu’aucun autre, donne ce sentiment d’évidence :
Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur.
(Phèdre, IV, 2)
C’est à son père Thésée, qui l’accuse d’un amour coupable, que le jeune Hippolyte affirme par ces mots son innocence.
Ce que nous dit cette phrase est facile à saisir : elle exprime bien la clarté d’un cœur. Les termes employés « jour/pur/cœur» retentissent en nous pour nous donner cette impression de pureté, de transparence. Le « jour » surtout est riche de connotations : il renvoie à une expérience fondamentale de l’homme, celle de la lumière naturelle, des grandes belles journées qui effacent les ombres et clarifient toute chose. Bien prêter attention à ce qu’évoque en nous le vers nous permet de mieux mesurer sa portée.
Mais à ce premier regard, tourné vers notre impression, doit en succéder un second, centré sur l’expression. L’habitude d’expliquer les textes nous permet de recenser les quelques éléments suivants :
• La mise en valeur du mot « jour »
en début de vers : il sert de point de comparaison, il inscrit d’emblée le thème de la clarté dans l’esprit de l’auditeur (le terme étant saisi dans toute sa force symbolique) ;
• L’ordre dans lequel est établie la comparaison : il ne s’agit pas de poser la simple équation « mon cœur est pur comme le jour », mais — nuance essentielle — d’opérer le mouvement inverse : c’est le « jour » qui ne parvient pas à être plus « pur» que le « cœur ». En inversant le comparant et le comparé, l’auteur établit que le jour est d’une pureté inaltérable, première, si essentielle que le plus pur des jours ne saurait l’égaler. Vous me suivez ?
• La succession des mots est d’ailleurs remarquable : elle nous conduit du monde extérieur (pureté du jour) vers le monde intérieur (fond du cœur). Habituellement, ce qui est apparent est clair, ce qui est profond l’est beaucoup moins. Ici, c’est le fond même du cœur qui a plus de clarté que l’air du jour… Le personnage est donc bien d’une parfaite transparence.
• La simplicité même du vers contribue à cette limpidité de son sens : d’une part, tous les mots sont des monosyllabes ; d’autre part, leur déroulement régulier est marqué par quatre accents toniques (mis en caractères gras ci-dessous) qui mettent en valeur les mots essentiels :
« Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur. »
• Enfin, l’écho des voyelles longues que prolongent les « r », -our, -ur, -œur, semble étudié pour mieux fondre ensemble les sens des trois mots clefs : jour/pur/cœur.
Le personnage à qui Racine prête ce vers est donc toute transparence dans ce qu’il dit comme dans la façon dont il le dit. Si l’on connaît cette tragédie, on sait qu’Hippolyte est aux antipodes mêmes de Phèdre qui, elle, se débat dans une passion sombre et coupable. Ce vers prend ainsi une dimension nouvelle, par le contraste qu’il opère entre la pureté de l’innocence du jeune homme et la noirceur du « crime » de l’héroïne. L’explication s’achève sur cette remarque. L’essentiel est dit.
Au cours de ce bref commentaire, nous venons d’explorer méthodiquement deux voies :
• Une recherche sur nos impressions, en principe subjectives, pour mieux saisir ce que nous éprouvons ;
• Une recherche sur les moyens d’expression employés dans ce vers, pour mieux comprendre ses effets ;
Mais, dans chacune de ces voies, nous ne pouvions oublier complètement l’autre…
C’est qu’il fallait bien, en analysant notre impression, avoir à l’esprit les mots clefs du vers et une certaine connaissance de leurs connotations ; corollairement, en recensant les moyens d’expression, nous devions tenir compte des effets que nous avions perçus en nous-mêmes. Ainsi se dessine une méthode en trois temps, véritable triangle d’or de l’explication de texte :
Je ressens Je recense
Je relie
Il faut ressentir, préciser et analyser en soi la gamme des impressions que produit le texte.
Il faut recenser, observer dans le texte la gamme des moyens d’expression qu’il recèle.
Il faut relier ce que l’on a ressenti à ce que l’on a recensé, et réciproquement, dans un va-et-vient maîtrisé.
JE RESSENS : des impressions globales aux sensations particulières
Nos réactions aux textes sont souvent vagues. Aussi faut-il apprendre à ressentir.
Ressentir, bien sûr, c’est d’abord recevoir le sens global du texte. C’est « comprendre », entrer en compréhension profonde (exactement comme l’on essaie de « comprendre » quelqu’un), et non pas simplement saisir des idées abstraites. C’est entrer en résonance avec le corps du texte.
En effet, à la signification précise des mots se mêlent toujours des évocations secondes, des « connotations », des représentations intérieures qui ne nous touchent pas au seul niveau cérébral. On peut palpiter, rire, transpirer d’effroi, pleurer, être réconforté ou désespéré à la lecture de certaines pages. Nos souvenirs, notre culture, notre émotivité, tout participe à la lecture. Il faut donc apprendre à observer méthodiquement tout ce qui se passe dans notre conscience face au texte.
Nous avons parlé dans l’article précédent du « grand livre de la vie » que nous avons tous dans notre esprit. Ce dictionnaire vivant nous habite, avec son immense réservoir de mots et d’images, d’expériences et de rêves, de significations et d’interrogations. Il est structuré dans notre mémoire par le biais du langage. C’est grâce à lui que nous pouvons « lire », c’est-à-dire trouver un sens et une « réalité » à ce que nous lisons. Avant même la lecture du texte, il nous faut donc savoir reconnaître ce réseau intérieur qui va retentir au texte, en fonction de la nature de celui-ci.
Dans un premier temps, nous allons fouiller dans notre mémoire et nous interroger sur les impressions préliminaires, déjà installées en nous, que nous pouvons avoir sur le thème que traite une page littéraire. Cela s’appelle reconnaître en soi l’horizon d’attente. Par exemple, si j’ai à commenter le poème « Les Aveugles » de Baudelaire, je puis d’abord me demander : « Qu’est-ce qu’un aveugle pour moi ? Comment ai-je réagi, enfant, quand j’ai pris conscience que des gens ne voient pas ? Ai-je eu peur ? Ai-je eu pitié ? Ai-je eu le sentiment que ces gens-là ont un mystère ? Qu’ils ont la vision d’un autre monde ? etc. » Une telle mise au point va me permettre de mieux recevoir les effets du texte, de mieux situer son originalité par rapport aux stéréotypes de la conversation courante, ou par rapport à d’autres textes que je connais sur le même sujet.
Puis, en cours de lecture, je noterai l’évolution de mes impressions. Un page produit rarement une atmosphère unique, globale et uniforme. Il y a des intensifications, des modifications, des contrastes, des convergences. Il faut être attentif à tout ce qui varie dans notre impression, et surtout, prendre garde à ce qu’une impression (marquante pour nous en raison de notre sensibilité) n’efface pas les autres, tout aussi importantes. On peut d’ailleurs changer d’impression sur tel ou tel passage, en le relisant…
En fin de lecture, évidemment, le bilan de nos impressions successives pourra être comparé à ce que nous avons déjà observé dans la vie ou dans d’autres textes. La règle est de ne jamais banaliser, de ne jamais réduire l’effet d’un texte à l’effet produit par d’autres textes, mais au contraire, de différencier les impressions que peuvent nous faire des pages portant sur des thèmes ou des situations similaires. Bien entendu, cela suppose qu’on affine ses réactions premières, et qu’on entre dans le détail.
C’est ce que vont nous permettre, justement, les impressions particulières. Là encore, il va falloir observer en soi. Au fil des phrases, ligne après ligne, vers après vers, on va préciser la « représentation » que les mots tissent en nous-mêmes. Leur déroulement est comme un petit film projeté sur l’écran de notre conscience. Significations, perceptions (visuelles, sonores), connotations, inflexions rythmiques, tout cela forme une chaîne, un flux qui conduit notre imaginaire. Suivez bien votre film intérieur : le moindre détail d’un texte impressionne votre cerveau comme une pellicule… Il faut alors, aussi lentement que possible :
• Retentir aux mots, aux groupes de mots. Pour l’écrivain, ceux-ci ne sont pas des signes abstraits : ils renvoient toujours à des réalités sensibles, à ses souvenirs, ses expériences, ses rêves. Les « espaces » pour Pascal, la « douleur » pour Baudelaire, « l’absurde » pour Camus, ne sont pas de vains mots. Ils sont chargés de connotations. Pour bien recevoir le texte, il faut examiner le halo particulier, le petit éclat intérieur que chaque mot, lentement prononcé, peut faire naître en nous. Il faut chercher quelle expérience, quel souvenir personnel, entrent en résonance avec les images de l’auteur. Il faut tenter de rejoindre la sensibilité de l’écrivain à partir de nos émotions personnelles, qu’il soit question du vent, de l’automne, d’un deuil, de la joie d’aimer, ou de l’indignation devant l’horreur.
• Voir en soi. Que percevons-nous exactement, comment notre imaginaire est-il visuellement touché ? Si, par exemple, Nerval nous parle du « soleil noir de la Mélancolie », avant de reconnaître telle ou telle figure de style, cherchons l’image que l’expression fait jaillir dans notre esprit. Fermons les yeux pour mieux voir : voici un soleil négatif, dardant des rayons noirs ; l’opposition avec notre perception habituelle de l’astre éblouissant nous plonge dans un autre monde ; nous pénétrons alors dans la vision d’un poète dominé par la puissance mortifère de la Mélancolie. Nous pourrons ensuite identifier le rôle de l’oxymore et la force de la métaphore : mais nommer ces figures de style n’aurait pas suffi si nous n’en avions pas ressenti d’abord les effets singuliers.
• Savoir écouter . Les textes agissent doublement sur notre oreille : par les sons et les bruits du monde auxquels ils renvoient ; par les sonorités et les rythmes dont ils se constituent eux-mêmes. Dans l’un et l’autre cas, il faut être conscient des éléments auditifs qui nous impressionnent. Considérons par exemple la célèbre strophe, si mélodique, de Verlaine :
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.
On ne peut bien ressentir cette phrase que si l’on se remémore le son caractéristique du violon : il faut évidemment se souvenir en soi de sa vibration prolongée (qui justifie que les « sanglots » soient qualifiés de « longs »). Mais il faut aussi écouter, simultanément, le déroulement lent de la phrase sur les six vers de la strophe (par exemple, en la disant à haute voix). Nous y retrouvons justement, dans les échos sonores, dans la modulation rythmique des vers, cette « vibration » du violon qu’ils sont chargés d’évoquer. Sans cette double perception préalable, on ne pourra pas « expliquer » un texte dont on n’a pas écouté la poésie musicale. Viendra ensuite l’étude des effets objectifs du texte (diérèse, assonances, accents rythmiques, allitérations). Mais l’un ne peut aller sans l’autre.
Le lecteur qui veut bien nous suivre fera sans doute une objection de taille : et si l’on ne ressent rien ? Si l’on est « sec » devant une page qui semble archaïque, ou écrite dans une autre langue que celle qu’on a l’habitude d’entendre ? Si l’on n’a pas du tout d’impression ?! Que faire ? Faudra-t-il faire semblant ?
Je pourrais être tenté de répondre : pourquoi pas ?
En réalité, il est rare qu’on soit totalement dénué d’impression, surtout si l’on veut bien relire le texte une ou deux fois en suivant la méthode que je viens d’indiquer. Quoi qu’il en soit, le fait que certains lecteurs ne ressentent rien au premier abord montre bien qu’il faut apprendre à ressentir, surtout à la lecture des textes classiques.
Mais il y a tout de même quelques recours devant une page qui ne nous « inspire » rien. C’est de se servir de son bon sens et de se demander : « Compte tenu du thème de ce texte et de son déroulement, que devrais-je ressentir ? Qu’est-ce que l’auteur — si je compare à d’autres extraits que je connais sur le même sujet — peut bien vouloir produire comme effets ? » Ces questions renvoient le lecteur à l’observation objective du texte. Faute d’émotion immédiate qui pourrait le guider, il doit regarder les mécanismes mis en œuvre dans la page, chercher la loi de son fonctionnement : bref, il va partir de la seconde voie d’accès au texte, le recensement. Et peut-être parviendra-t-il, en étudiant le texte avec sa seule intelligence, à y trouver des aspects, des processus, un climat qui vont, peu à peu, éveiller sa sensibilité. Les deux voies sont en effet complémentaires.
JE RECENSE : de la nature du texte à ses moindres procédés
Il s’agit d’observer le texte à tous les niveaux, de façon méthodique, en allant toujours du général au particulier.
• La nature du texte.
Un coup d’œil global, qui doit devenir spontané, doit nous permettre dès l’abord de discerner à quel type de texte nous avons affaire : descriptif, narratif, argumentatif, théâtral, lyrique, poétique. Non seulement en reconnaissant que nous sommes en face d’une page de roman, d’une scène tragique ou comique, ou d’une poésie ; mais encore parce que très vite nous devons identifier la tonalité (ou le registre) qui domine tel ou tel passage que nous devons commenter (didactique ? réaliste ? polémique ? ironique ? dramatique ? épique ? romanesque ? etc.). Nous pouvons déjà pressentir, par ce simple coup d’œil, quels seront les centres d’intérêt que pourra mettre en valeur le commentaire, et même deviner « le message » probable de l’auteur.
• Le mouvement du texte.
Les détails, les parties d’un passage, ne prennent vraiment tout leur sens, toute leur portée, que dans l’ensemble où l’auteur les a ordonnés. Il faut donc observer la page comme on observe un tableau : à bonne distance. Voir ainsi les grands masses qui le composent, les éclairages dominants, les progressions ou les contrastes étudiés, bref, le plan ou le rythme du texte. À ce stade de l’examen, on va donc saisir (même sans rien « ressentir ») le travail de composition de l’artiste. Les débuts et les fins de passages méritent une attention particulière : l’auteur y laisse voir comment il veut nous prendre ou nous surprendre, où il veut nous emmener, dans quelle atmosphère il désire nous entraîner. Les dernières phrases d’un paragraphe, les « chutes » de certains poèmes, nous renseignent la plupart du temps sur l’effet dominant, sur ce à quoi le texte voulait en venir…
• Le texte lui-même.
Sans recenser les innombrables aspects d’un texte (car sa nature et son mouvement peuvent déjà limiter nos axes de recherche), on pourra, pour l’examiner, puiser dans la gamme des éléments suivants :
- L’énonciation. Pour un écrivain, l’énonciation, c’est l’acted’écrire. Les éléments constituants de cet acte transparaissent dans l’énoncé : ce sont les indications relatives au lieu et au temps où l’énoncé est produit (ou encore, où il affecte d’être produit), à la personne qui est censée s’exprimer, à celle à qui l’énoncé s’adresse. Devant un texte, il est donc essentiel de se poser les questions suivantes : Qui parle ? A qui ? Où ? Quand ? Comment ? L’auteur choisit-il d’intervenir explicitement dans ce qu’il énonce ? Préfère-t-il mettre en scène un narrateur ? Pourquoi rapporte-t-il un récit à la première, à la troisième ou à la seconde personne ? De quel point de vue (sans toujours l’avouer) décrit-il un lieu, une scène ? Où se place-t-il par rapport à ses personnages (quelle « focalisation » adopte-t-il ?) Comment est conduit le regard du lecteur dans une description ? Celui-ci est-il mis à distance ? Ou placé à côté du héros, voire dans le for intérieur du héros, pour faciliter l’identification ? Autant de questions qui dépassent la seule étude du style au sens strict, mais sont inhérentes à tout regard objectif sur un passage.
- La nature du vocabulaire. Le choix des mots est décisif, qu’il s’agisse de textes entiers ou de simples tournures. Le vocabulaire est-il concret, figuré ? Se rapporte-t-il à l’action, à la description, à l’analyse psychologique ? Quels sont les temps utilisés ? Les pronoms les plus fréquents ? A quelles sensations dominantes obéit le choix des mots (vue/ouïe/toucher/odorat ?) Quels éléments de la nature (ou du monde social fait-il intervenir ? Y a-t-il des champs lexicaux particulièrement révélateurs ? Comment se répartissent (se mêlent ou s’opposent) les divers registres du vocabulaire (animal/végétal/humain) ? Le style est-il globalement soutenu, recherché, simple, familier, prosaïque ? Les termes veulent-ils nous plonger dans un univers réaliste, dramatique, métaphysique, surréaliste ? Les adverbes et les adjectifs, à la base de la modalisation, révèlent-ils les sentiments, les préjugés du locuteur, etc. ?
- La phrase et son expressivité. La place des mots est également déterminante. La phrase elle-même peut être concise, hachée, ample, périodique, selon les réalités évoquées ou selon le « souffle » de l’auteur. Ce repérage sera ensuite à relier aux significations : pour l’instant, il faut le conduire sans a priori. L’un des éléments essentiels de l’expressivité sera naturellement la présence de figures de style. Il faut les repérer tout de suite. Il peut s’agir de figures portant surtout sur la construction de la phrase (apostrophe, ellipse, anaphore, antithèse, chiasme), ou surtout sur l’expression de la pensée (figures d’insistance ou d’atténuation : métaphore, hyperbole, métonymie, litote, euphémisme), mais les unes et les autres sont liées dans le tissu du texte.
- La versification. Les aspects propres aux poèmes, versification, effets sonores (allitération, accents toniques, assonances, rimes), phénomènes d’enjambement et de rejet, doivent être reconnus et maîtrisés dans l’étude de la poésie. À ce sujet, deux écueils sont à éviter :
• Faire des remarques formelles inutiles : dire qu’un sonnet a quatorze vers ou qu’un alexandrin a douze syllabes n’explique rien, puisque c’est la norme ;
• Inversement, expliquer un texte poétique sans tenir compte de son expressivité rythmique et musicale, comme s’il ne s’agissait que d’un texte en prose, conduit à en manquer la vraie dimension.
Dans tout ce travail de recensement, il faut s’attacher aux effets volontaires, manifestes, ceux qui traduisent un effort d’expression notable de la part de l’auteur. Comment les isoler les uns des autres ? C’est justement en opérant un va-et-vient continuel entre les deux approches du texte qu’on y parviendra.
JE RELIE : le va-et-vient entre l’impression et l’expression
Il s’agit maintenant de mettre en relation les deux relevés.
D’un côté, nous avons constaté des pressions ressenties au-dedans de nous-mêmes : ce sont les im-pressions.
De l’autre, nous avons repéré les pressions que la forme du texte essaie d’opérer à l’extérieur d’elle-même, sous la poussée du « vouloir dire » de l’auteur : ce sont les ex-pressions.
Lorsque les unes et les autres se correspondent, nous pouvons alors faire état objectivement des effets du texte. Effet de réel, effet de sens, effet d’atmosphère, effet d’émotion, etc.
Expliquer le texte, ce sera établir ces effets et en commenter la portée, en partant tantôt des impressions, tantôt de l’expression. C’est leur correspondance qui sera décisive. D’où ce schéma :

Quelle que soit la forme de l’explication (écrite ou orale, linéaire ou méthodique), la règle sera donc :
-de ne faire état d’aucune impression qui ne soit appuyée sur les indices textuels du texte ;
-de ne relever aucun moyen d’expression sans préciser son effet (vérifié) sur le lecteur.
Dans la pratique, le plus simple est d’opérer (au brouillon) par recherches successives, alternant le « je ressens » et le « je recense », pour chaque aspect ou chaque partie du texte à étudier. Chaque aller-retour que je fais entre mon impression et les expressions me permet un contrôle immédiat des effets du texte : le « je relie » est toujours présent à mon esprit. De plus, je puis ainsi entrer dans le texte progressivement, affinant aussi bien mes réactions successives que mes repérages. Enfin, cette méthode m’aide à élaborer peu à peu des hypothèses de lecture que je vérifie aussitôt, processus qui est à la base même de ce qu’on appelle maintenant « lecture méthodique ». Cela donne :

Et ainsi de suite. Lorsqu’on s’entraîne à l’explication, qu’il s’agisse de paragraphes ou de simples phrases, ce processus devient vite automatique. Bien sûr, après ce travail de recherche, il faudra ordonner les résultats, classer les effets du texte par centres d’intérêt, faire un plan de commentaire, etc. Ainsi progressera l’analyse vers la spécificité de la page et de son art.
APPLICATION SUR UN EXEMPLE
Prenons l’exemple d’une longue phrase extraite du roman de Barjavel, La Nuit des temps (1968). Il y est question d’un personnage et d’un groupe d’hommes qui se trouvent près du pôle sud, aux prises avec les éléments hostiles de l’Antarctique, le vent et la glace. Voici l’évocation de leur lutte :
« Il n’en pouvait plus de toute cette glace et de ce vent, et de ce vent, et de ce vent qui ne cessait jamais de s’appuyer sur lui, sur eux, sur tous les hommes de l’Antarctique, toujours du même côté, avec ses mains trempées dans le froid de l’enfer, de les pousser tous sans arrêt, eux et leurs baraques et leurs antennes et leurs camions, pour qu’ils s’en aillent, qu’ils débarrassent le continent, qu’ils les laissent seuls, lui et la glace mortelle, consommer éternellement dans la solitude leurs monstrueuses noces surglacées… »
(René Barjavel, La Nuit des temps, Presses Pocket)
Commençons par « ressentir ». Il n’est pas inutile d’abord de nous remémorer nos souvenirs de saisons froides, nos premières expériences de la neige, du vent et de la glace, mais aussi les images que divers documentaires sur les pôles ont « archivées » dans notre esprit. Nous voici dans l’ambiance. À la lecture du texte, notre première sensation peut être une sensation d’excès, d’impuissance et de saturation devant l’acharnement du froid et du vent, — sensation commandée par l’attaque du paragraphe : « Il n’en pouvait plus. »
Observons le texte. Notre impression première vient d’une part de ce début du paragraphe, qui nous associe à ce qu’éprouve le héros, mais surtout des procédés d’insistance répartis au fil du texte : l’expression de l’absolu et de la totalité par exemple (« Toute cette glace » ; « qui ne cessait jamais » ; « les pousser tous sans arrêt » ; « toujours du même côté » ; « éternellement »).
Approfondissons. Que nous nous tournions vers notre film intérieur ou vers le texte objectif, nous allons observer qu’à cette impression de permanence dans le temps se joint une impression d’omniprésence dans l’espace. C’est d’ailleurs un double effet que l’on retrouve souvent : dans les textes descriptifs, l’une des clefs de l’explication consiste à étudier en parallèle tout ce qui est de l’ordre du temps et tout ce qui est de l’ordre de l’espace (cf. la phrase de Pascal commentée dans notre premier article).
Ici, l’omniprésence du vent est soulignée par de nombreuses répétitions : « et de ce vent, et de ce vent, et de ce vent » ; « sur lui, sur eux, sur tous les hommes » ; « les pousser tous […], eux et leurs baraques et leurs antennes et leurs camions » ; « pour qu’ils s’en aillent, qu’ils débarrassent le continent, qu’il les laissent, […] ».
Notre impression se précise alors : il n’y a pas simple excès, mais sentiment de suffocation devant ce souffle ininterrompu, omniprésent, irrésistible.
Retournons au texte : nous pouvons affiner notre observation. Les répétitions qui nous sont apparues sont des anaphores : l’anaphore est un procédé classique de renforcement, de gradation, par la mise en série de même débuts de phrases, ou de membres de phrase. Ces gradations caractéristiques (« sur lui, sur eux, sur tous les hommes » ; « qu’ils s’en aillent, qu’ils débarrassent le continent, qu’ils les laissent ») correspondent littéralement à l’effet de progression du vent, en mettant en valeur les seuls obstacles (les seuls « reliefs ») sur lesquels s’acharne le vent : les humains et leur matériel.
Nous « voyons » de mieux en mieux l’action du vent. Il est le grand acteur de ce texte.
Et en effet, la syntaxe est ici révélatrice. Alors que cette phrase a pour sujet grammatical un homme (« il », au départ du texte), la longue subordonnée qui suit, et qui s’étage sur huit lignes, fait place à un autre sujet bien réel, le vent omniprésent :
« ce vent qui ne cessait
de s’appuyer
de les pousser tous
pour qu’ils s’en aillent
(pour) qu’ils débarrassent
(pour) qu’ils les laissent seuls, lui et la glace,
consommer… »
Cette syntaxe n’est pas à observer du seul point de vue visuel. Plaçons-nous du point de vue auditif. Écoutons notre impression : elle consiste en un déroulement rythmique, qui apparaît assez bien dans le schéma ci-dessus. Les virgules y jouent un peu le rôle de pauses du vent, alors que les gradations miment la reprise incessante des rafales. On constate qu’il est quasi impossible de prononcer cette phrase, avec ses répétitions anaphoriques, sans éprouver vocalement une sensation d’essoufflement. Au contraire, les deux dernières lignes, prolongées par le point de suspension, semblent couler sans difficulté : c’est que le vent est victorieux, et que rien ne s’oppose plus à ses « monstrueuses noces » avec la glace.
Tout n’est pas dit. Alors que cette évocation, jusqu’alors, nous donnait une impression de réalisme, l’irruption soudaine du thème des noces, en plein Antarctique, ne manque pas de nous surprendre. Devant nous s’ouvre le spectacle inhumain et paradoxal d’amours glaciales, entre le vent et la terre gelée. Le vent a été personnifié.
Relisons le texte : cela apparaissait déjà lorsque l’auteur évoquait les « mains » du vent, « ses mains trempées dans le froid de l’enfer. » La personnification des éléments les rend souvent plus proches de nous, plus « humains » ; mais elle peut aussi, à l’inverse, les rendre d’autant plus inquiétants qu’ils semblent avoir des intentions : ils savent ce qu’ils font. C’est bien le cas ici : le vent est un être bizarre, qui se plaît dans l’enfer du froid, qui vit des noces glaciales, ce qui est effectivement monstrueux, aux antipodes de l’expérience normale des hommes (qui associent l’amour à la chaleur). La personnification, les oxymores (« froid de l’enfer », « noces surglacées »), ont ainsi tiré le texte du côté du fantastique (en accord d’ailleurs avec le thème général du roman), là où un lecteur pressé n’aurait reçu qu’une fugace impression réaliste.
Ce va-et-vient entre la saisie des impressions et le regard sur le texte nous permet ainsi à la fois de mieux le comprendre et de mieux le ressentir. Nous cernons mieux le texte comme système à produire des effets. Cela suppose bien sûr une bonne connaissance de la plupart des moyens d’expression dont use un écrivain. Mais cela suppose aussi une habitude de lire les textes, et de les confronter avec le grand livre intérieur (d’expériences et de lectures) qui, peu à peu, s’édifie en nous-mêmes. Car une page ne prend son sens, sa portée, son originalité que par comparaison avec tous les autres textes qui constituent une culture. Aussi parle-t-on d’ailleurs de plus en plus d’intertextualité, — notion qui mériterait un petit article à elle seule.




/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fwww.algerie-plus.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Fyasmina-khadra.jpeg)
/idata%2F0384571%2F12-07%2Faurelia.jpg)
/image%2F0551053%2F201304%2Fob_a0e0d0_602080-580013762022961-125585298-n.jpg)
/image%2F0551053%2F201304%2Fob_1d26bc_stylo-plume-parker-sonnet-laque-noire-intense-ct.jpg)
/idata%2F2732718%2Flitterature%2F374002_2482140468771_553826139_n.jpg)